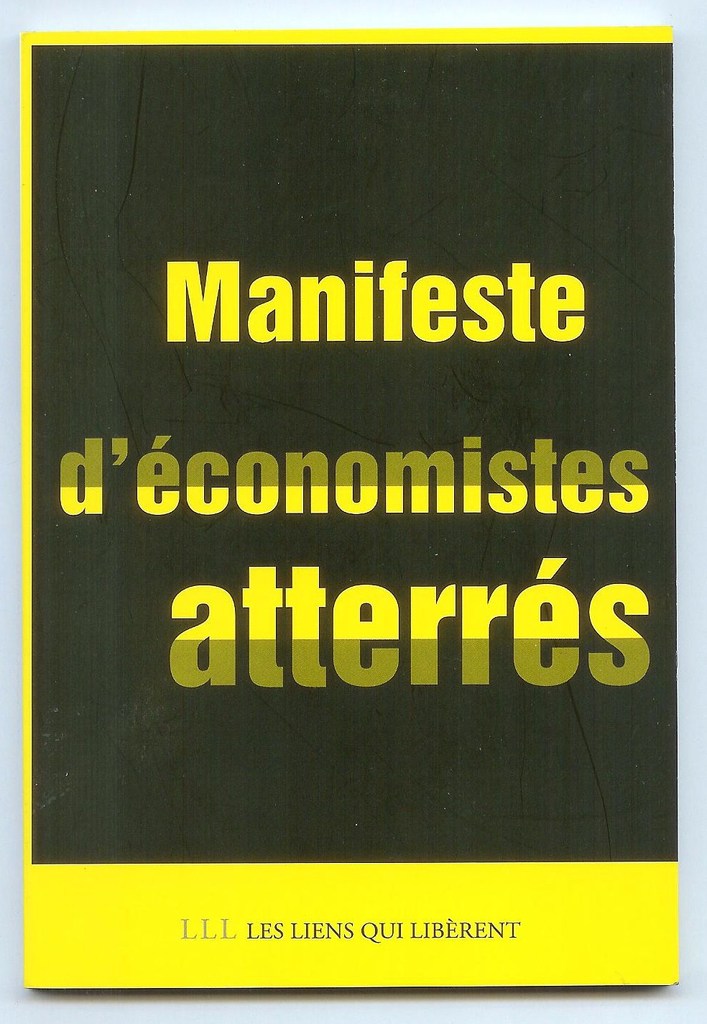Dans la mesure où ces transferts ont été exclus, que ce soit dans le traité de Maastricht ou encore, plus récemment, dans le traité de Lisbonne, la zone euro était malheureusement condamnée.
Si la Grèce sort de la zone euro, n’ouvre-t-elle pas la voie à l’implosion de celle-ci, sachant que d’autres pays comme l’Espagne ou l’Italie sont aussi en difficulté ?
Jacques Sapir : Effectivement, une sortie de la zone euro par la Grèce, et même simplement l’annonce d’un défaut, ne serait-ce que partiel, déclenchera un processus de contagion qui touchera tout d’abord le Portugal, puis, très rapidement, l’Espagne, et enfin, l’Italie, la Belgique, et finalement la France.
Ce processus d’implosion de la zone euro, par ailleurs, n’est pas seulement lié à la contagion que provoquerait la sortie de la Grèce, il faut savoir qu’un pays comme l’Espagne devra faire face à une situation sociale et économique très difficile en 2012. En effet, les allocations chômage en Espagne ne durent que deux ans. Et l’on voit à ce moment que plus de la moitié des chômeurs, qui représentent aujourd’hui 21 % de la population active, se retrouveront sans aucune ressource. Cela imposera soit des dépenses importantes pour les solvabiliser, soit des dépenses tout aussi importantes pour solvabiliser les banques, qui seront confrontées à des prêts non remboursés de manière massive. La crise de la zone euro apparaît aujourd’hui comme inéluctable.
Y a-t-il un risque, si la Grèce ne sort pas de la zone euro, de voir des pays « forts », comme l’Allemagne, quitter cette dernière ?
Jacques Sapir : C’est effectivement une possibilité. Par exemple, si l’Allemagne était isolée sur la question des eurobonds, ou de la monétisation directe de la dette – soit le rachat par la Banque centrale européenne, directement aux Trésors publics, d’une partie de leur dette. On sait que ces deux solutions ont été évoquées. Or, elles sont en réalité inconstitutionnelles du point de vue de l’Allemagne.
Le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe a rappelé la semaine dernière que le gouvernement allemand ne devait pas donner son accord à une mutualisation de la dette, excluant ainsi la possibilité des eurobonds, et il a rappelé que l’euro n’était acceptable pour l’Allemagne qu’à la condition qu’il garantisse aussi la stabilité monétaire, comme le faisait le mark. On voit donc que la cour constitutionnelle a fermé la porte à ces deux solutions.
Si l’Allemagne sortait de la zone euro, ce ne serait d’ailleurs pas une catastrophe. Le deutsche mark retrouvé se réévaluerait fortement par rapport à l’euro maintenu. Les pays de la zone euro pourraient ainsi rééquilibrer leur commerce extérieur avec l’Allemagne. Mais politiquement, c’est une solution qui apparaît très peu probable. Il est à craindre que nos gouvernements s’obstinent dans des perspectives de sauvetage de la zone euro et qu’ils soient acculés d’ici à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine à la perspective d’un éclatement général de cette zone.
Pensez-vous comme Jacques Delors que c’est le manque de réaction de la zone euro qui plombe la Grèce ? L’UE ne semble pas avoir les moyens de sauver la Grèce alors que ce pays représente le PIB des Hauts-de-Seine. La crise grecque n’illustre-t-elle pas la faillite de l’UE et de ses institutions inadaptées ainsi que la mise en avant des égoïsmes nationaux ?
Jacques Sapir : La réaction de Jacques Delors est juste, mais bien tardive. Comment pouvons-nous prendre au sérieux un homme qui a conçu un système dont l’aboutissement logique est la crise actuelle, et qui vient maintenant déplorer celle-ci ? Il faut rappeler le rôle extrêmement néfaste qu’ont eu un certain nombre d’hommes politiques français, ainsi que des hauts fonctionnaires, qu’il s’agisse de Jacques Delors, de Pascal Lamy ou d’autres, dans la déréglementation financière généralisée que nous avons connue en Europe à partir de 1985-1986. Sur le fond, on a voulu faire avancer la solution d’une Europe fédérale sans le dire aux populations.
La construction européenne a été faite de telle manière qu’elle incluait des déséquilibres structurels dont les pères de l’Europe espéraient que les solutions iraient chaque fois un peu plus en direction du fédéralisme.
Ce fédéralisme furtif, ou clandestin, comme l’on veut, ne tenait pas compte des réactions des peuples, et ne tenait pas compte de l’enracinement extrêmement profond des nations qui constituent l’Europe. On peut toujours aujourd’hui reprocher aux différents pays leurs égoïsmes, on peut toujours
aujourd’hui reprocher aux classes politiques de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, leur manque d’initiative et leur aveuglement face à la crise de l’euro, qui était une perspective inévitable depuis 2009.
Mais sur le fond toutes ces incompétences renvoient en réalité à un projet politique. Ce projet qui avait été refusé lors du référendum de 2005, que ce soit en France ou aux Pays-Bas, et que l’on a cherché à imposer malgré tout via la notion de contrainte économique. Mais les faits sont têtus, et quand on les méprise, ils se vengent.
On nous parle de l’exposition des banques (françaises ou pas) à cette dette grecque. Mais les prêts octroyés aux banques après la « crise des subprimes » ont été rapidement remboursés. Ne vaudrait-il mieux pas injecter de l’argent dans les banques trop exposées, plutôt que de prêter à une Grèce qui n’aura jamais la possibilité de rembourser ?
Jacques Sapir : Le problème des banques est bien sûr celui des dettes grecques qu’elles détiennent, et au-delà celui des dettes portugaises, espagnoles et italiennes. Bien entendu, on peut toujours injecter de l’argent dans les banques, et d’une certaine manière ce serait certainement plus efficace que de chercher à tout prix à sauver la zone euro. Mais il faut savoir
qu’aujourd’hui l’opinion, dans différents pays européens, est très hostile aux banques. Alors un scénario possible consisterait à nationaliser les banques, à se servir de cette nationalisation pour faire accepter la recapitalisation des
banques, mais en utilisant aussi cette nationalisation pour mettre de l’ordre dans les systèmes bancaires, et en particulier rétablir la distinction impérative entre banques de dépôts et banques d’affaires, et très sérieusement limiter le nombre d’opérations que les banques ont le droit de faire.
D’une certaine manière, toute crise correspond à un risque et à une opportunité. Nous avons aujourd’hui l’opportunité de nous saisir de cette crise pour réformer en profondeur nos systèmes bancaires, pour mettre fin à la financiarisation qui dicte sa loi depuis la fin des années 1980, et pour recréer les conditions de stabilité d’un grand pôle de crédit alimentant à la fois les entreprises et la population. De ce point de vue, la crise peut être utile.
Pensez-vous qu’aujourd’hui il y a un moyen de « sauver » la zone euro ? Si oui, quel est-il ?
Jacques Sapir : On pourrait sauver, au moins temporairement, la zone euro soit par la mutualisation de la dette ou par l’émission massive par la Banque centrale européenne de crédits au profit des Etats membres. Ce que l’on appelle la monétisation de la dette. Mais comme je l’ai dit, ces deux options sont exclues, à la fois pour des raisons politiques, mais surtout juridiques, par l’Allemagne. Je rappelle ici que la cour de Karlsruhe, dans son arrêt rendu il y a une semaine, a tué dans l’œuf toute possibilité de rebond.
Et si la Banque centrale européenne décidait de prêter directement aux Etats, au lieu de prêter aux banques, qui elles-mêmes prêtent aux Etats, une nouvelle plainte devant la cour constitutionnelle de Karlsruhe aboutirait à ce que cette dernière rende un avis d’inconstitutionnalité sur cette pratique. Cela, le gouvernement allemand le sait, et il ne pourra donc pas accepter une telle solution. Nous voyons donc qu’aujourd’hui les deux solutions pour sauver, ne serait-ce que temporairement, la zone euro sont de fait exclues.
D’un point de vue juridique, comment peut-on sortir de l’euro ?
Jacques Sapir : La zone euro ne prévoit pas de mécanisme de sortie. Mais elle ne prévoit pas non plus de mécanisme pour expulser un pays contrevenant à ses règles. Cette situation juridique tout à fait extraordinaire démontre bien que la zone euro était institutionnellement très fragile. On peut d’ailleurs imaginer que certains pays décident de réquisitionner leur banque centrale, et décident que leur banque centrale se mette à octroyer des crédits en euros à leur gouvernement. Cela provoquerait une crise politique très grave qui pourrait soit se solder par l’éclatement de la zone euro, soit par la sortie de l’Allemagne et de ses pays satellites, l’Autriche et la Finlande, de la zone euro.
La solution la plus simple et la plus judicieuse consisterait néanmoins dans une autodissolution de la zone euro, un peu sur le modèle de l’autodissolution de la zone monétaire nordique que la Suède, la Norvège et le Danemark avaient constituée dans les années 1920, et qui a été dissoute avec la crise de 1929. Cette autodissolution, se faisant de manière ordonnée, permettrait alors à chaque pays de fixer le taux de change de sa monnaie retrouvée, en concertation avec les autres pays. Cette solution aurait le grand avantage de maintenir une concertation monétaire minimale entre les pays qui composaient la zone euro, et pourrait permettre de reconstituer des mécanismes monétaires une fois que la crise serait passée.
Mais ce que l’on doit craindre aujourd’hui, c’est que les gouvernements, pris d’un entêtement infantile, renoncent à une telle solution jusqu’au moment où ils seront contraints par la réalité de l’envisager, et ceci se fera alors dans une atmosphère de crise, de très grandes récriminations entre les pays, et en particulier entre la France et l’Allemagne, et généralement dans des conditions politiques tout à fait détestables.
En 2013, le SPD arrivera sans doute au pouvoir en Allemagne, et il est très favorable à l’Europe fédérale. Ne pensez-vous pas que cela permettra d’aller vers des solutions comme la monétisation de la dette (quitte à ce que la Constitution soit modifiée en Allemagne) ?
Jacques Sapir :
L’hypothèse d’un changement constitutionnel en Allemagne ne saurait être à l’ordre du jour avant plusieurs années. Le destin de la zone euro se jouera dans les semaines ou les mois qui viennent. Il n’est simplement plus temps de rêver à de telles solutions.
Vous dites que la sortie de la Grèce de la zone euro permettrait une dévaluation. Il me semble que cela augmente l’inflation. Est-ce envisageable dans un climat social déjà agité en Grèce ?
Jacques Sapir : Il est inévitable qu’une dévaluation de très grande ampleur, et celle-ci ne devrait pas être inférieure à 40 % pour la Grèce, entraîne par la suite une poussée d’inflation. De ce point de vue, c’est le taux de change réel, autrement dit le taux de change corrigé des taux d’inflation, qui doit nous servir d’indicateur. Mais en même temps, aujourd’hui, les tensions inflationnistes dans la zone euro sont relativement faibles.
Elles ne sont pas les mêmes entre pays, ce qui est d’ailleurs un problème, mais elles sont relativement faibles. Dès lors, l’inflation doit être acceptée comme un mal nécessaire pour qu’un pays puisse bénéficier des avantages de la dévaluation.
 Photo Reuters – John KOLESIDIS (Le Monde)
Photo Reuters – John KOLESIDIS (Le Monde)