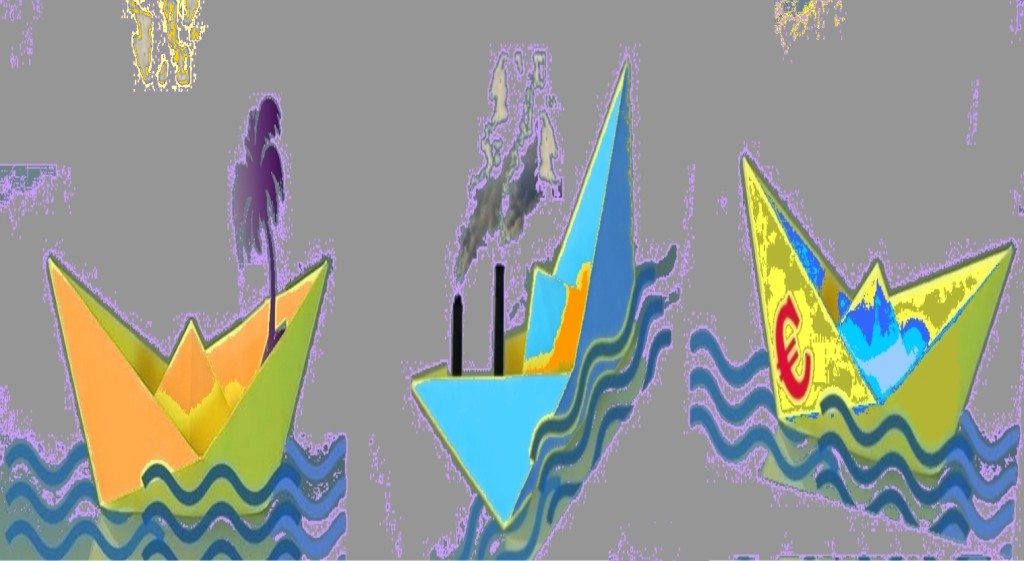Bonjour!
Je livre ici quelques extraits d’une conversation à bâtons rompus. Qui échappa, je l’espère, aux bâtons de chaise.
(Les bâtons de chaise sont connus pour leur parole rugueuse et capricieuse, voire brutale, tandis que les bâtons rompus, comme la glace, et brisés, comme le silence, délivrent un discours de feu et de chaleur, excellant dans tous les registres. Seul leur échappe peut-être, à ces brillants causeurs, ce que l’on a dit de Mozart, dont la musique paraît-il habitait encore le soupir qui la suivait. …Mais une raison en était que le pauvre Wolfgang-Amadeus n’avait pas le temps de vieillir! Ce temps n’est jamais donné que faussement, comme à nous, à notre table à bâtons, où nous le payons au prix de la frivolité.
– Oh là. Attention… Mettons les parenthèses, et ne nous égarons pas!)
…
Quelle est la part des services dans le PIB? Banques et assurances comptent-elles parmi les services?
Il est d’usage de parler de « biens et services » .
1 – Les « biens » sont « tangibles »: on peut les toucher, ils sont matériels. La bière au magasin. Tous les objets matériels.
Il y a deux grandes catégories de biens: ceux de consommation, utilisés par un consommateur dit final car il n’en fera ni production ni commerce. Et ceux dits d’investissement, qui durent plusieurs années et servent à produire et à vendre: les machines, les bâtiments. (Ceux qui servent à produire mais ne durent pas plusieurs années sont dits des fournitures.)
Comme de nombreux biens, une même voiture peut être ou une consommation ou un investissement. Achetée par un particulier pour son usage personnel, elle sera un bien de consommation, et achetée pour l’exercice professionnel d’un membre du personnel d’une entreprise, elle sera un bien d’investissement, car dédiée à une production.
2 – Les « services » sont des « biens intangibles »: on ne peut les toucher. La bière qui vous arrive à table au bistrot, la coupe de cheveux, les restaurants, tous ces secteurs: entretien, réparation, médecine, assurance, banques, soins aux personnes, administration, police, armée, transports, services publics, postes, enseignement, la culture, les divertissements, la presse…
Les services représentent actuellement (terme plus prudent que « désormais ») autour de 72 % du PIB aux EU, et autour de 73% du PIB de l’ensemble des 28 pays de l’UE (2013).
On voit bien que le prix des services, se faire servir un repas au restaurant, le verre de bière au bistrot, contient les prix d’un tas d’ingrédients tangibles, tant que nous ne nous nourrissons pas d’aliments virtuels, et vu qu’il y faut partout des outils, machines et immeubles très tangibles pour que ces ces services puissent être, non pas rendus, mais vendus. « Rendre service » n’est pas une catégorie économique! Rendre service, c’est hors commerce, c’est la vie humaine non marchande, omniprésente, éternelle, bien plus large, plus ancienne et de plus d’avenir que la vie marchande capitaliste chiffrée.
Cependant, la part des restaurants (ou des journaux, ou des théâtres, ou des hôpitaux, ou des transports…) dans le PIB est-elle leur chiffre d’affaires, le total de leurs ventes, les prix des biens matériels nécessaires à leur activité y étant inclus, ou est-elle leur valeur ajoutée, la différence entre leur chiffre d’affaires et tous leurs achats?
Les services comme les biens, toutes les productions, sont repris dans le calcul du PIB, le « produit intérieur brut », ou du PNB (notion presque équivalente mais source de difficultés statistiques), le « produit national brut », pour leur seule valeur ajoutée, sans quoi il y aurait de nombreuses productions comptées plusieurs fois!
La valeur ajoutée représente la contribution du secteur à la production de richesses nationale, sectorielle ou territoriale, représentée par la notion du PIB. Cette notion est critiquable et critiquée, mais on ne s’en passe pas vraiment.
Est-ce que les services peuvent croître indépendamment des ressources matérielles?
Que la production indéfinie dans un monde physique fini est impossible, est un constat qui se répand dans les consciences, vu que nous en sommes à une période historique où cette impossibilité commence à se manifester concrètement.
Cependant nos vieilles idées résistent. Elles nous soufflent: « Pour les biens qui sont physiques, d’accord, il y a une limite à la croissance. Mais ne peut-on envisager une croissance indéfinie des services, de la culture, des soins aux personnes âgées, …, même dans un monde fini? »
Cette idée est induite par le fait que les services sont définis comme immatériels.
Hélas, aucun service ne peut se développer sans un minimum d’environnement matériel, ne serait-ce qu’un bureau, un téléphone et un ordinateur. Les biens immatériels collent à des biens matériels et ne peuvent exister dans la pure immatérialité.
Il faudrait voir, pour chaque production de services (dont la valeur ajoutée vaut aujourd’hui autour de 72 % du PIB, tant aux États-Unis que dans l’Union Européenne à 28), combien de % du PIB en biens matériels sont indispensables à sa réalisation. On pourrait alors tenter de maximiser la croissance (du PIB) avec des entrants matériels donnés ou minimaux, au bénéfice de la production d’un maximum de services. (Un pitoyable exercice en fait: la sacro-sainte croissance est aussi une idéologie et une propagande. Il s’agit de faire espérer et patienter les pauvres pour un avenir indéfini, tandis que dans l’immédiat, et depuis trop longtemps, ils raquent et paient: une traite sur l’avenir, qui ne mange pas le pain des riches.) Mais cette politique ne changerait rien, à part un différentiel provisoire et limité, à l’impossibilité de la croissance indéfinie dans un monde aux ressources matérielles finies, puisqu’il n’y a aucun service possible sans environnement matériel.
Même le poète, producteur archétypique de bien immatériel, n’existe que grâce à des frais éducationnels et aux soins qu’il a reçus dans ses années de formation, autant qu’à ceux qui assurent sa vie et sa survie au quotidien.
Quand on parle de croissance, on parle de croissance de la production, évaluée par ce fameux PIB.
On dit aussi « production de richesses » . Par facilité, par poésie, et par tradition, le grand livre d’Adam Smith, fondateur de l’économie politique à l’époque industrielle, ayant pour titre Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, ou, en résumé, La richesse des Nations.
Mais c’est plus compliqué que ça.
Lorsqu’une maison brûle et que l’assurance intervient, tous les coûts qui s’ensuivent sont comptabilisés comme une production. Ce n’est pas faux, mais incomplet: nulle part la destruction de richesse, matérielle ou monétaire, due à l’incendie, n’est comptabilisée en richesse ou production négatives.
De même, le secteur de la réparation automobile est compté comme une production de richesses. Mais la casse n’est pas comptée comme une destruction.
Il y a plus. Dans notre système de comptes, n’importe quelle production est une source de « croissance » à partir du moment où elle est chiffrée, indépendamment de l’usage qui peut en être fait.
Chiffrer le monde est une grand source d’illusion, et pas seulement pour le calcul du PIB. Chiffrer permet de comparer tout et n’importe quoi, de faire des équivalences qui évacuent les qualités intrinsèques des réalités par ailleurs représentées par les chiffres. C’est un vaste sujet, mais limitons-nous pour le moment au fétiche moderne appelé PIB.
Fabriquer des chars et des armes en quantité est calculé comme un accroissement de richesses: cela a distribué des salaires, certes, mais les chars n’améliorent le quotidien de personne. Et même, ils sont conçus pour détruire et pour tuer.
Si on avait construit à leur place, pour un même montant, des maisons confortables et des écoles ou des hôpitaux, ça ferait une différence! Eh bien, cette différence n’existe pas dans le PIB. Pour le discours du PIB, les deux situations sont identiques.
[Il y a une notion intuitive de valeur, à la fois distincte et parfois férocement antagonique du prix. Tenter de faire des relations chiffrées entre les deux est …une tentation, et Karl Marx y a succombé. En accord avec les grands économistes qui l’ont précédé, il a développé un concept de valeur-travail, distincte du prix. Mais cela ne lui a pas fait échapper à des impasses ou à des insignifiances.
Les économistes d’université qu’on appelle « néo-classiques » ont abandonné depuis 1860-1870, toute étude de la valeur. Pour faire court, disons qu’ils l’ont remplacée par un concept tautologique (qui tourne sur soi, comme le serpent qui se mord la queue) d’utilité, diaphane, éthérée, subjective, que personne ne voit ni ne calcule, mais qui expliquerait les prix tout autant que les prix la dévoileraient. S’il n’y a plus de chapitre consacré à la « valeur » dans leurs traités, contrairement à ceux, appelés économistes « classiques », qui les ont précédés, il ne faut pas voir dans cette évaporation un progrès de la science économique néo-classique! Les néo-classiques ont simplement écarté un questionnement qui menait à des mises en cause gênantes du rapport salarial et de l’ordre bourgeois.
Plus récemment, Paul Jorion relève une erreur de traduction d’Aristote qui a occulté depuis le XIIIe siècle la pensée du philosophe sur ce point. Cette traduction étant corrigée, on ne peut penser de la valeur selon Aristote, et contrairement à ce que la scolastique en a prétendu, qu’une seule chose: la valeur n’a pas de prix. Elle n’a pas de rapport simple, calculable ou consubstantiel, au prix. L’impossibilité de penser la valeur en termes économiques montre l’impossibilité de « définir un univers autonome de l’économique, clos sur lui-même et se suffisant à lui-même : au sein duquel seules des explications purement économiques rendront compte de faits économiques, eux aussi » , et montre que « ce que nous appelons « l’économique » n’est en réalité pas « autonomisable » en tant qu’« économique » : que sa détermination ultime est en-dehors de lui, dans les rapports de force entre propriétaires fonciers, capitalistes et travailleurs. » (Jorion, 2011)
Or la question de la valeur paraît incontournable à la conscience commune, comme elle l’a paru à Smith, Ricardo et Marx. Et nul n’y peut rien. En imposer la méditation aux économistes, imposerait un retour au réel de leurs théories. Le fronton sous lequel ils travaillent porte la phrase: « Nul n’entre ici s’il ne croit que tout s’achète et que rien n’a de valeur« . …À mettre à l’imparfait le jour où leurs instituts seront des musées et que tous nous saurons l’impossibilité d’établir un savoir économiste autonome, chiffrable, calculable et computable à merci. Que voilà une chose lointaine pour une vérité simple!
La mise en chiffres de ce secteur étroit des conduites humaines, que l’on range sous le terme d’économiques, n’est qu’un jeu sur l’écume légère à la surface des eaux, dont les conclusions hasardeuses s’exposent à être sans cesse démenties et détruites par les forces qui animent les grands fonds …et les grands vents.]
[Quelqu’un a dit que si un (petit-)bourgeois épouse sa femme de ménage, il fait baisser le PIB.
Oui, à la condition que l’épouse fournisse le travail de la bonne, ce qui est implicite dans l’esprit petit-bourgeois: elle le fera, et gratuitement, CQFD.]
Production de richesses.
Les richesses, pour un pays, c’est une chose.
Et la richesse d’un être humain, c’en est une autre. C’est un rapport à ses voisins. La richesse, c’est l’état d’être riche. On s’en fiche d’être plus riche que dans le passé, surtout lointain. Être riche, c’est aujourd’hui, et c’est par rapport à ses voisins, pas par rapport aux habitants du bout du monde.
Être riche, c’est un rapport au temps, où l’on échappe à une damnation de travail immédiat et non choisi pour vivre ou survivre, cas extrême et tellement banal dans la communauté humaine à ce jour. Et la richesse, c’est un rapport à autrui. C’est avoir les moyens de faire travailler autrui pour soi, un chèque sur le travail d’autrui. Si avec ton revenu ou ta fortune ou ton statut, tu peux vivre et bien vivre, et en plus payer des gens à construire ta maison, à entretenir et réparer ta voiture et mieux encore à te conduire dans ta voiture, les payer à ton service, tu es riche. Les payer à t’enrichir, ce que la propagande appelle « leur donner un emploi », c’est encore mieux. Vivre à l’hôtel, manger au restaurant, ne jamais cuisiner, ni nettoyer, ni laver son linge, ne pas se raser soi-même. Vous avez déjà regardé attentivement Berlusconi? Il a la tronche d’un type qui ne se rase pas lui-même. Et si ce n’est pas lui, c’est son voisin.
La plus belle question que j’ai entendu poser à des militants est celle-ci: Révolutionnaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes? On a bien vu que jusqu’à présent les révolutions n’ont fait que produire ou reproduire des classes riches. Encore un autre sujet.
Si on comptabilisait les dégâts environnementaux?
À notre époque où la mise à mal de l’environnement naturel, tel qu’il est nécessaire à notre bien-vivre (la nature elle, elle s’en fiche), n’est plus niable, à notre époque où toutes les preuves et images de saccage et de pollutions diverses se répandent, on ne peut s’empêcher de commencer à se poser des questions.
Les premières réponses, spontanées, vont proposer des extensions des vieilles recettes. La plus répandue est celle-ci: donnons un prix à la pollution, et « les gens » cesseront de polluer. Tous? Ou seulement les plus pauvres?
L’écologie capitaliste crée des marchés de « droits de polluer », de « certificats verts », de « droits de tirage CO2 », etc, pour essayer d’assainir les pratiques productives, où les uns reçoivent des primes s’ils investissent dans des pratiques considérées comme propres ou plus propres, et où ceux qui polluent doivent payer ces primes. Non seulement on a créé des marchés nouveaux pour régler ces échanges, mais en plus, il s’agit de marchés spéculatifs, ouvrant la porte à des pratiques de type financier. La finance, c’est l’industrie du pari entre opérateurs étrangers à toute activité en rapport avec les prix sur lesquels on parie. J’achète des droits de tirage CO2, mais uniquement pour les vendre avec un bénéfice, n’ayant aucun besoin ni aucun usage de ces droits.
L’idée de comptabiliser les dégâts environnementaux est une extension de l’esprit de la comptabilité au traitement de l’environnement naturel.
Cette extension des catégories du calcul et de l’économie a tout pour être abusive. Elle se fonde sur un refus de penser le problème dans sa globalité.
Le fond effectif de cette attitude, c’est de traiter la question avec des recettes qui ne touchent pas, ou le moins possible, à un certain statu quo.
C’est la croyance libérale qui nous inspire ce type de réponse ou pseudo-réponse. Ne nous voilons pas la face, nous baignons dans une véritable et quotidienne propagande. Si les ressources sont très chères, on va en consommer moins. Mouais. Bonne chance. On continue pareil, mais quel frein va-t-il empêcher de réserver les consommations aux classes les plus riches? La réponse libérale au problème environnemental, je ne vois pas à quoi d’autre ça peut mener. On sait de quelle merveilleuse façon le libéralisme a fait ses preuves dans le traitement des questions de la faim, de la dette, des budgets nationaux, des rapports entre pays dominants et pays pauvres.
Il y a une autre façon de respecter la nature: c’est la loi, l’interdit, la norme, la culture…
L’écologie de gouvernement d’aujourd’hui n’est pas dans cette vision. Elle s’inscrit parfaitement dans le vaste renoncement des États et des esprits à la politique, en faveur de la gestion. Cela dure très clairement depuis au moins les années Thatcher (1979) – Reagan (1980) – Mitterrand la rigueur (1983). Mais Alain Supiot en observe les germes dès Verdun durant la première guerre mondiale.
Alain Supiot?
Je le vois comme un analyste génial, doublé d’un consensuel qui joue à l’optimiste de la raison (je me demande s’il y croit vraiment, au retour de la raison qu’il annonce à ses heures.) Il nous dit, avec de solides auteurs derrière lui (Polanyi, La Grande Transformation), ceci:
Le capitalisme repose sur trois fictions: la nature, le travail et la monnaie sont considérées comme des marchandises.
Et dès lors, toujours selon Alain Supiot, seul le droit, la norme, peut assurer que ces fictions soient à la fois respectées et rendues humainement supportables. Bon, il est juriste. Ces fictions, quant au travail et à la nature, paraissent clairement mortifères. Elles ont été supportées, d’accord, mais l’histoire des deux derniers siècles n’a pas été paradisiaque! La nature ne serait pas une marchandise? C’est assez évident. Le travail n’est pas une marchandise non plus? Hmm… Ce n’est pas ce que la télé ou les journaux nous racontent chaque jour, mais si vous me demandez vraiment ce que je pense y voir… Le travail humain, une marchandise qui s’achète et se vend…? Oui, au pays des patrons. …Mais dans mon pays à moi, celui de ma raison, celui de mon coeur, celui que je voudrais pour les enfants des enfants de mes enfants, euh… Non. C’est non. Quant à la monnaie, la fiction de son état de marchandise est plus difficile à juger. Repos. On verra demain.
À partir du moment où on dérégularise de plus en plus, nous dit Supiot, c’est à dire où l’on supprime en nombre des normes juridiques, des limites conventionnelles propres à une société et à ses valeurs, on va aux aventures, aux impasses et aux explosions sociales. Comme la dé-normation est la plus avancée dans le domaine de la monnaie, c’est là que la crise a frappé d’abord, ajoute-t-il.
Dans cette vision, la crise qui vient est déjà là, aussi, dans le domaine des relations de travail (le domaine d’étude initial de Supiot), lesquelles tournent à la sauvagerie: banalisation du burn out et de la souffrance au travail, loi Macron en France (travail le dimanche), troïka en Grèce, business as usual de l’austérité pour les pauvres partout en Europe, nombreux pays sans débat, alors que le Prix de la Banque de Suède Jean Tirole plaide pour une réforme du code du travail (dans le sens de la précarité rebaptisée flexibilité, dans le sens d’allègements des obligations de l’employeur en cas de licenciement, …) Par ailleurs les relations de travail raniment aussi la conflictualité, qui vaut toujours mieux que l’anesthésie, le « glacis de la normalisation ». Comme l’illustre cette actualité récente, scandale pour les uns, de la chemise déchirée du directeur des « ressources humaines » d’Air France, mais bon signe pour d’autres, ainsi Frédéric Lordon.
Et la crise sera notoire aussi, ou l’est déjà, dans les effets du saccage du milieu naturel.
Alain Supiot nous donne une très belle analyse d’une très vilaine affaire. Je poserais un bémol pour sa vision de la sortie de crise: « le retour à la raison ». Il paraît peu probable que bien des passions et des déraisons ne se manifestent, et l’issue n’a jamais rien de certain.
J’ai lu un premier petit livre, – petit en pages -, d’Alain Supiot: L’esprit de Philadelphie. Simple, accessible, tranchant, percutant.
Et son cours du Collège de France des deux dernières années est en librairie depuis peu, nettement plus imposant: La gouvernance par les nombres. Voyez sa quatrième de couverture!
…
Bien! Il se fait tard.
Assez pour cette fois.
Bonne nuit, Bruxelles, bonne journée, Pékin, bonne soirée, Medellin.
Guy